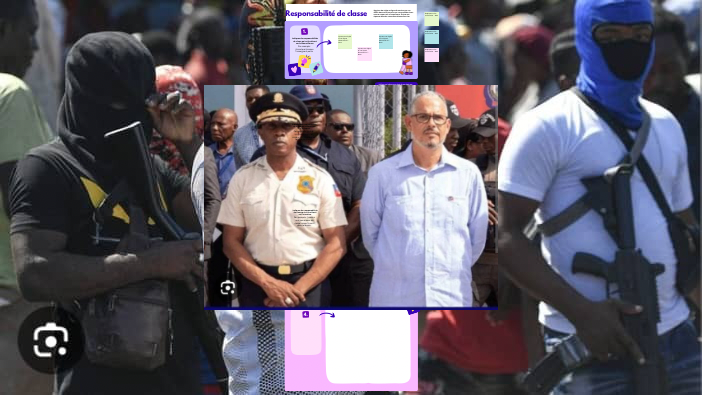La situation actuelle en Haïti illustre l’échec manifeste du pouvoir en place à garantir la sécurité et la stabilité du pays. Tandis que les gangs étendent leur emprise sur la capitale et les villes environnantes, les dirigeants semblent plus préoccupés par leurs intérêts personnels que par le sort de la population. L’assassinat récent de policiers et de soldats kenyans de la Mission Multinationale de Soutien (MMS) met en lumière cette faillite sécuritaire. Pourtant, au lieu d’une réaction coordonnée et efficace, les autorités se livrent à une gestion chaotique, marquée par des décisions incohérentes et une absence totale de planification. Cette situation témoigne non seulement d’une incapacité structurelle, mais aussi d’un profond mépris pour l’intérêt collectif.
L’insécurité atteint un niveau critique. Depuis la fin février, des attaques meurtrières ont été enregistrées à Kenscoff, Carrefour-Feuilles, Tabarre, Delmas, Léogâne et Savien. La capitale est aujourd’hui contrôlée à plus de 80 % par des groupes armés qui dictent leur loi. La police nationale, censée protéger la population, est abandonnée par un gouvernement qui opère sans réelle concertation avec elle. L’usage des drones kamikazes, présenté comme une avancée technologique, s’avère inefficace en raison d’une gestion désastreuse. Pendant ce temps, la Primature et la Direction Générale de la PNH se livrent une guerre d’influence, paralysant ainsi toute stratégie de lutte contre les gangs. Cet échec est d’autant plus flagrant qu’un an après l’installation du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), aucun foyer de gangs n’a été démantelé et aucune route nationale n’a été sécurisée. Pourtant, chaque membre du CPT coûte à l’État environ 50 000 dollars US par mois, une somme exorbitante pour un gouvernement incapable d’assurer la protection de ses citoyens.

Le cas des soldats kenyans, notamment l’assassinat à Savien, illustre encore cette confusion au sommet de l’État. Alors que les autorités haïtiennes parlent d’assassinat, le commandement kenyan évoque une disparition. La presse kenyane rapporte qu’une mère, dont le fils a été identifié dans une vidéo diffusée par les gangs, attend désespérément son retour. Cet événement remet en question l’utilité d’une force étrangère face à un État haïtien qui refuse de prendre ses responsabilités. De nombreux Haïtiens estiment que la solution à la crise sécuritaire ne viendra pas de l’extérieur, mais d’une réelle volonté politique nationale. Ils rappellent que ceux qui prétendent combattre l’insécurité sont les mêmes qui en tirent profit et qui se maintiennent au pouvoir grâce au chaos ambiant.
Face à cette situation alarmante, la solution ne peut être que haïtienne. Il est impératif de réviser la gouvernance actuelle, marquée par une fragmentation excessive avec neuf présidents, neuf cabinets et des cortèges interminables, alors qu’Haïti est le seul PMA (Pays Moins Avancé) de l’Amérique. Cette gabegie institutionnelle ne fait qu’aggraver la crise. Il faut rétablir une gouvernance efficace, recentrée sur les besoins de la population, avec une réduction drastique des privilèges accordés aux dirigeants. La réforme de la police, accompagnée d’une stratégie nationale de lutte contre les gangs, doit être une priorité. Mais surtout, les Haïtiens doivent prendre conscience que le changement ne viendra ni des États-Unis, ni du Kenya, ni de l’ONU. Seule une mobilisation citoyenne, unie et déterminée, pourra mettre fin à ce système où l’insécurité est devenue une arme de pouvoir.