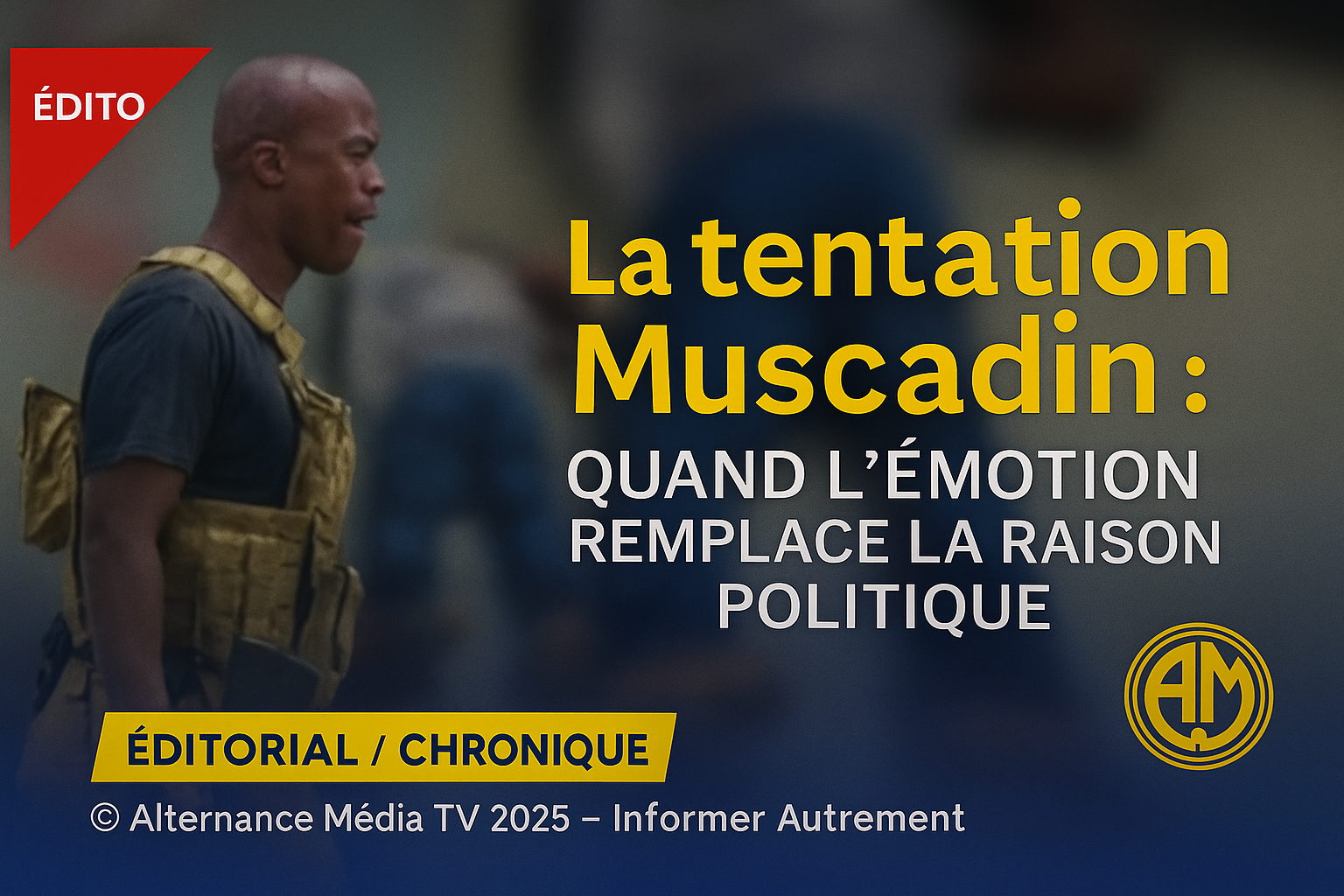Entre fascination populaire et dérive autoritaire, Jean Ernest Muscadin incarne la tentation haïtienne d’un « homme fort ».Adulé sur les réseaux sociaux, il cristallise une émotion collective où la soif de sécurité l’emporte sur la raison. Mais derrière l’image du justicier, se cache un produit du système qu’il prétend combattre, explique, dans sa chronique , Tanes DESULMA, directeur de la rédaction « ALTERNANCE MÉDIA « ….
La fièvre Muscadin : quand l’émotion remplace la raison
Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux s’enflamment autour d’un mot d’ordre : « Jean Ernest Muscadin président ! »
Des vidéos virales, des slogans, des montages glorifiant le commissaire du gouvernement : la Muscadin mania s’installe.
À Alternance Média, nous refusons de réagir à chaud. Notre rôle n’est pas de suivre la foule, mais d’éclairer le citoyen.
Avant de scander un nom, il faut savoir de qui l’on parle, d’où il vient, et ce qu’il représente réellement. L’apparence est souvent trompeuse : ce qui est visible n’est pas forcément vrai.
La question n’est pas : « Muscadin peut-il être président ? » — en démocratie, ce sont les électeurs qui tranchent, pas une foule sur Facebook ou TikTok.
La vraie question est : que dit ce phénomène de notre rapport à l’émotion et à l’État ?
L’émotion politique et la théorie des foules
En politique, l’émotion est une force redoutable. Elle renvoie à des réactions affectives soudaines – joie, colère, admiration, peur, fierté, tristesse – provoquées par une situation particulière.
Lorsque ces émotions se propagent, elles peuvent générer des comportements collectifs jugés irrationnels : émeutes, paniques, liesses.
C’est exactement ce que nous observons aujourd’hui avec la Muscadin mania.
Ce que ses partisans font sur les réseaux sociaux relève de ce que les politologues Gabriel Tarde et Gustave Le Bon( XIXème siècle) appellent la théorie des foules . Pour ces derniers : la foule est une unité versatile, crédule, irresponsable ; par contagion, les individus finissent par penser et agir à l’unisson.
Cette lecture est d’autant plus inquiétante qu’elle s’inscrit dans une société haïtienne traversée par l’anomie, la désintégration des liens sociaux et la violence généralisée.
Dans ce contexte, la foule cherche un homme fort. Elle croit l’avoir trouvé. Mais d’où vient cet homme ?
Qui est vraiment Jean Ernest Muscadin ?
Ce que beaucoup feignent d’oublier, c’est l’origine politique et les fréquentations de Jean Ernest Muscadin.
Il est issu d’un univers où se croisent duvaliérisme, réseaux paramilitaires, PHTK et milieux politico-économiques opaques. Ses détracteurs le décrivent comme un homme de l’ancien système, proche de ceux qui ont alimenté la criminalité qu’il prétend aujourd’hui combattre.
Il est un obligé d’Hervé Fourcand, figure centrale du Sud, sanctionné par plusieurs pays pour blanchiment d’argent, trafic de drogue, financement des gangs armés, trafic d’armes et de munitions. Il a également été lié à Evinx Daniel, un acteur majeur du trafic, disparu dans des conditions troubles jamais élucidées.
Muscadin a été l’un des organisateurs de la campagne de Michel Martelly dans le Sud en 2010, et reste aujourd’hui encore associé à cette galaxie politique.
Il est également connu comme proche de Rony Célestin, lui aussi sanctionné pour trafic de drogue, d’armes et financement de gangs criminels.
À cette liste s’ajoute désormais Steeve Kahwly, autre homme d’affaires et politique dont le nom circule dans les mêmes sphères.
Autrement dit, Muscadin n’est pas une météorite tombée du ciel de la moralité publique : il est le produit d’un système qu’il prétend, aujourd’hui, combattre.
Fort avec les faibles, faible avec les forts
On présente souvent Muscadin comme un « dur », un homme à poigne qui n’a pas peur des bandits.
Dans la pratique, sa façon de définir le criminel interroge : il est fort avec les faibles, faible avec les forts.
Il multiplie les opérations spectaculaires contre de petits délinquants, des gens arrêtés dans des bus, parfois sur la base de simples dénonciations, et exécutés sans procès.
Mais les vrais cerveaux du crime, ceux qui organisent les trafics, financent les gangs, contrôlent les ports, les pistes clandestines et les flux d’armes ? Ceux-là ne semblent jamais inquiétés par lui.
S’il voulait vraiment aider à Jérémie, dans le Sud ou le Sud-Est, il saurait très bien où sont les stocks d’armes et de drogue, qui sont les trafiquants, qui contrôle quoi.
On ne peut pas avoir des bandits « à sa patte » sans bandits en vestes et cravates.
Et pourtant, les rares personnalités de premier plan qui ont été arrêtées ces dernières années l’ont été par la DCPJ, pas par Jean Ernest Muscadin.
Cela aussi, il faut le dire clairement.
Quand la violence se pare du masque de la justice
Les mêmes membres de la diaspora qui, aujourd’hui, revendiquent Muscadin comme modèle de sécurité, avaient été consternés le 23 juin 2023 lorsque le jeune Nahel, 17 ans, fut tué à Nanterre par un policier lors d’un contrôle routier.
La France s’était enflammée, des quartiers entiers étaient à feu et à sang, des infrastructures et magasins détruits, alors même que l’auteur du tir mortel avait été arrêté.
Les Haïtiens vivant aux États-Unis n’ont pas oublié non plus l’affaire George Floyd, tué le 25 mai 2020 à Mennisota par le policier Derek Chauvin. Le monde entier s’en est ému ; le genou à terre est devenu un symbole planétaire de protestation contre les violences policières.
Pourquoi alors, quand il s’agit d’Haïti, certains acceptent-ils, voire applaudissent-ils, des exécutions sommaires ?
La brutalité n’est pas plus acceptable parce qu’elle se drape de bleu et rouge.
Muscadin et l’État : une incompréhension profonde
Au-delà de la personne, le problème Muscadin révèle une méconnaissance totale de ce qu’est un État.
Un État, ce n’est pas un homme.
C’est un système de domination légitime, doté de la personnalité morale, chargé d’exercer la souveraineté sur un territoire et une population. Il s’incarne dans des organes – chef de l’État, Parlement, gouvernement, pouvoir judiciaire – et dans une administration qui doit servir l’intérêt général, non des intérêts privés.
Dans les régimes démocratiques modernes, la légitimité vient du consentement du peuple, exprimé selon la Constitution. L’État se distingue de la société civile, dont il doit assurer la sécurité et protéger les libertés, notamment en monopolisant la violence légitime.
Or, les déclarations publiques de Muscadin montrent qu’il ne comprend ni la séparation des pouvoirs, ni les limites de ses fonctions.
Il a ainsi pu déclarer :
« Poum ta mete yon chèf polis ou yon minis jistis pou paleman di m w ap revokel oubyen ou pa vle ? »
Comme si le Parlement pourrait disparaître par la simple volonté d’un homme, en l’espèce le président, sans aucune révision constitutionnelle. Ce n’est pas le président qui décide le fonctionnement de nos institutions, mais la constitution. Sinon, il faut qu’il organise un coup de force, destitué le CPT et se déclarer président à vie, François Duvalier, dont il est un digne héritier.
Dans une autre interview, il raconte :
« Mwen te jwenn yon kamyon k ap soti Miragoâne, mwen rele prezidan pou m di l sa, prezidan ak madanm li di m pa fouyel e mwen oblije kite l ale. »
Autrement dit, il admet lui-même ne pas agir selon la loi ni selon les pouvoirs que lui confère sa fonction, mais selon les consignes d’un chef d’État et même de son épouse.
C’est la négation pure et simple de l’indépendance de la justice et de l’État de droit.
La peine de mort déguisée n’est pas un projet de société
Exécuter sommairement des individus – qu’ils soient bandits ou pas – ne saurait être un programme politique.
Nous sommes opposés à la peine de mort, et ce n’est pas un slogan : c’est une exigence de justice.
Dans des pays comme les États-Unis, la France, l’Allemagne ou le Canada, des personnes condamnées à mort ou à perpétuité sont parfois reconnues innocentes après 30, 40 ou 50 ans, voire après leur décès, malgré des enquêtes menées avec des technologies avancées.
En Haïti, sans moyens, sans expertise scientifique, sans garanties procédurales, que vaut une exécution « sur dénonciation » ?
Combien d’innocents ont déjà payé de leur vie le besoin de spectacle d’un « homme fort » ?
Les véritables magistrats qui défendent la justice sont ceux qui ont eu le courage d’envoyer en prison un ancien président comme Nicolas Sarkozy, alors même que le ministre de la Justice était son filleul politique, le ministre de l’Intérieur son allié, et le chef de l’État en exercice son ami.
Le jour où Jean Ernest Muscadin commencera à faire arrêter les véritables criminels — et non à les exécuter — notre regard pourra évoluer. Pour l’instant, ce n’est pas le cas.
Refonder l’État et la Nation, pas célébrer un justicier
Le drame d’Haïti, aujourd’hui, est double :
un État effondré, une Nation fracturée, dont une partie de la population semble avoir fait sécession du reste.
Une nation, c’est une communauté d’appartenance, en grande partie imaginaire, mais qui permet de penser le peuple comme un groupe humain uni, aspirant à vivre ensemble. Elle repose sur une histoire commune, des liens affectifs, des références partagées, des critères culturels, sociaux, linguistiques ou géographiques entremêlés.
Ce qui nous manque aujourd’hui, ce n’est pas un cow-boy avec un fusil.
Ce qui nous manque, c’est un projet de refondation de l’État et de la Nation, capable de restaurer la confiance, la justice et l’égalité devant la loi.
L’émotion n’est pas un projet politique
En définitive, Jean Ernest Muscadin est moins un programme qu’un symptôme : le symptôme d’une société désespérée, prête à se raccrocher à un homme qui tire plus vite que son ombre, pourvu qu’il lui donne l’illusion de la sécurité.
Mais l’émotion n’est pas un projet de société.
Haïti n’a pas besoin d’un tueur à gages qui protège les grands bandits en veston tout en exécutant des présumés bandits de seconde zone ou des innocents.
Haïti a besoin d’un État, de lois appliquées de manière égale, d’institutions fortes, d’une Nation rassemblée autour d’un destin commun.
Le reste – slogans, vidéos, hystérie collective – n’est que fumée.
Et la fumée, tôt ou tard, se dissipe.
Tanes DESULMA
Directeur de la rédaction, Alternance Média TV
📧 alternancemediatv5@gmail.com